https://actualites.ecoledeslettres.fr/arts/cinema/une-vie-cachee-terrence-malick-ethique-et-politique/
« A Hidden Life » ( « Une vie cachée »), de Terrence Malick : éthique et politique
Il s’agit de mettre en place le cadre historique : l’année 1938, cruciale pour le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, dû à la politique agressive de conquête du Reich. Elle voit s’intensifier les pressions de l’Allemagne et des nazis autrichiens pour réunir leurs populations au sein d’une même nation. Les troupes de la Wehrmacht entrent en Autriche le 12 mars 1938 pour annexer, sans rencontrer la moindre opposition, ce pays qui lui fournit ses partisans et ses séides les plus enthousiastes.
Voulant revenir, comme dans La Ligne rouge (1998), à un cinéma moins abstrait, Terrence Malick a choisi de raconter l’histoire d’autant plus exceptionnelle de Franz Jägerstätter (20 mai 1907 – 9 août 1943), petit paysan autrichien du village de Radegund (qui devait à l’origine donner au film son titre), objecteur de conscience catholique au régime hitlérien, pour lequel la hiérarchie catholique incite cependant à voter par peur du bolchevisme et de la tendance d’Hitler à lui préférer le protestantisme. Seul à refuser son enrôlement dans la Wehrmacht en février 1943, il est emprisonné, puis exécuté à l’âge de 36 ans en août.
Le cinéaste a eu accès à ses carnets et à ses lettres écrites à sa famille de la prison, lettres pleines d’amour et de conviction à la fois morale et religieuse. Mais aux yeux de Malick, on le sait depuis le début de son œuvre, ce ne sont pas les institutions religieuses qui comptent, ce sont les Écritures et surtout la foi comme adhésion spontanée au mystère – moins chrétien que panthéiste – de l’univers.
Un héros christique
Puis, sur écran large et en couleurs, nous voilà transportés dans la campagne du Sud Tyrol autrichien par les images superbes d’une nature luxuriante filmées en numérique. On reconnaît immédiatement le style lyrique et la vision épique du cinéaste, mis en valeur par la photo de Joerg Widmer, opérateur Steadicam de Terrence Malick pour ses quatre précédents films auprès du chef-opérateur Emmanuel Lubezki, dont il a repris la place pour Une vie cachée. Panoramiques inspirés, magnifiques plans-séquences de moissons – thème cher à Malick comme dans Les Moissons du ciel (1978) –, divers travaux des champs filmés de façon quasi documentaire dans des décors et avec des éclairages naturels par des caméras légères, avec de nombreuses références aux plus célèbres toiles rurales du peintre Jean-François Millet : semailles, fauchaison, angélus.
Cette première partie est une merveille esthétique d’une fluidité et d’une harmonie parfaites soulignées par la bande son de James Newton Howard ; comme dans The Tree of Life (palme d’or à Cannes en 2011), elle décrit – grâce aux séquences par épisodes – la suite des saisons et des naissances en quelques plans caractéristiques séparés par des ellipses, brossant ainsi le tableau idyllique du bonheur conjugal d’un jeune couple et le charme bucolique d’une paysannerie comblée par une nature somptueuse.
Mais, dans cette pastorale, le ballet des faux aux mains des moissonneurs installe cependant le thème de la mort, la grande faucheuse, représentée sur la treizième lame du Tarot – auquel Malick a consacré le film Knight of Cups –, la seule à ne pas porter de nom ; son squelette couleur chair évoque la mue du serpent, dont les anciennes apparences tombent à terre et viennent servir d’engrais aux nouvelles. C’est une référence à la culture de soi, de nos créations et, à un niveau plus ésotérique, au résultat de notre volonté (on récolte ce que l’on a semé). En annonçant avec insistance la tragique fin du héros, les faux évoquent surtout la typologie chrétienne où tout prend son sens par la Crucifixion et la Résurrection. Ainsi, dans la peinture du Quattrocento, une Adoration des mages peut contenir en abyme une Passion ou une Pietà, un autel ou un berceau annonce le tombeau, le bœuf et l’âne de la crèche préfigurent les deux larrons crucifiés en même temps que Jésus.
De même chez Malick, tout dans les images de cette vie édénique en parfaite harmonie avec la nature laisse prévoir un destin christique : la cloche de l’église de Radegund dont le clocher se dresse à l’horizon et où Franz est sacristain sonnera son glas, son ami peintre – autoportrait de Malick ? – essaie sans succès de représenter le visage de Jésus en restaurant les fresques de l’église, les croix sont omniprésentes aux murs de la maison et même sous la forme de l’épouvantail dans un champ. Toute la symbolique chrétienne est mobilisée pour faire de cet opposant au régime nazi un martyr, un saint, l’image du Sauveur et de sa Passion. Malick entrevoit le sujet de son prochain film : le Christ.
Peu de dialogues dans cette première partie, mais un long monologue intérieur de Franz exprimant son amour pour sa femme, pour la nature et sa confiance en la justice divine selon le Psaume 22 (« Le Seigneur est mon berger / je ne manque de rien / Sur des prés d’herbe fraîche / il me fait reposer »). À partir du moment où Franz est en prison, s’installe un dialogue par lettres en voix off entre lui et son épouse. Ce couple qui n’avait jamais beaucoup parlé s’exprime alors maladroitement mais du fond du cœur avec une pudeur et une retenue particulièrement émouvantes.
Une certaine tendance du cinéma actuel
Mes articles précédents sur lui l’ont montré, je considère ce cinéaste comme l’un des plus grands du monde. Pourtant, alors que la majorité des critiques louent ce dernier film comme le meilleur parce que le plus narratif, il suscite en moi un malaise qui me fait penser le contraire. C’est dans l’abstraction, la confidence lyrique et la méditation que Malick excelle. Et l’intrigue qu’il a choisi de raconter ici me plonge dans la perplexité au lieu de me convaincre. De plus son attachement à la véracité du cadre, des décors naturels ou historiques me semble suspect. On comprend qu’il ait voulu aller en Autriche sur les lieux mêmes où à vécu son personnage pour retrouver leur authenticité et leur cachet, mais fallait-il pousser le souci de la vérité historique jusqu’à tourner dans les studios de Babelsberg, jadis dirigés par Goebbels, chef de la propagande nazie qui a produit Le Juif Süss de Veit Harlan ? Et dans le tribunal même du Kammergerich où les nazis ont condamné à mort tant d’innocents? D’autant plus que, curieusement, il a tenu à ce que les dialogues ou monologues des protagonistes (interprétés par les Allemands August Diehl et Valérie Pachner) soient en américain, tandis que les nazis s’expriment en allemand non sous-titré.
Terrence Malick semble bien avoir fait sienne cette tendance du cinéma actuel – allemand en particulier – à produire des films historiques sur le nazisme afin de porter l’attention du public germanique sur sa propre histoire et d’en mettre en scène les principaux acteurs. Réconciliation européeenne oblige ! Babelsberg a donc dû faciliter au maximum le travail du cinéaste auréolé de sa palme d’or. Le cinéma suit ou accompagne toujours le mouvement de l’histoire, mais force est de constater qu’il va toujours dans le même sens, comme l’ont montré entre autres le film de Marc Rothemund sur les jeunes résistants Hans et Sophie Scholl (2005), celui de Margarethe Von Trotta, Rosenstrasse (2003) qui rend hommage à ces femmes allemandes, qui en 1943 firent le siège d’un bâtiment où étaient emprisonnés leurs maris juifs et tant d’autres.
Certes, la prise en compte d’un tel passé est le seul moyen de le dépasser et de l’intégrer. À condition toutefois de ne pas monter en épingle ses rares épisodes positifs, de ne pas l’édulcorer, et de ne pas minimiser la responsabilité générale du régime et de ceux qui l’ont porté au pouvoir. Car cette tendance actuelle à mettre en exergue les victimes allemandes ou autrichiennes du nazisme revient à confondre – malgré la disproportion des chiffres – bourreaux et victimes dans une même compassion, qui brouille l’objectivité et la clarté du regard historique.
Malick ne minimise pas, il englobe et il estompe
Et on peut se demander ce que sait exactement Franz au printemps 1943, dans les alpages de son paradis campagnard, des agissements d’Hitler, des forfaits du nazisme. Ses carnets l’indiquent, il craint surtout pour la foi chrétienne et se demande comment on peut la concilier avec l’adhésion au national-socialisme, que son rêve, raconté au début du film, symbolise par un train où s’engouffrent des enfants et qui roule vers l’enfer. On pourrait voir dans cette image une allusion aux Juifs emmenés vers les camps. Pas du tout ; il l’interprète comme une allégorie du régime, incarnation du mal. Sait-il seulement que les Juifs existent ? Et que ces trains qu’il prend pour aller à Salzbourg ou à Berlin les emmènent vers la mort ? Il dit vaguement : « On tue des innocents. On envahit d’autres pays. On s’attaque aux faibles. » Il fait une petite allusion aux camps de concentration pour les récalcitrants politiques. Donc contre quoi se dresse-t-il précisément ? Contre un dictateur qui a annexé son pays à la satisfaction générale et dont il a pu seulement entendre vanter certains hauts-faits lors de la période militaire à laquelle il a été contraint et dont il est revenu sans dommage.
Son dilemme est purement personnel et moral. Cette opposition abstraite et théorique ne signifie d’abord qu’une chose : la Guerre en général est contre Nature dans tous les sens possibles et en particulier contre cette nature généreuse, à qui elle va enlever son protecteur, son producteur et un père de trois enfants. De quoi est-il accusé au juste? De résistance passive, de refuser de voter pour Hitler, de ne pas cautionner le nazisme ni lever le bras pour crier Heil Hitler. Son opposition est une opposition de principe, solitaire et entêtée – dictée par l’intime conviction de l’iniquité de ce régime – qui lui a valu d’être décapité. Et il est probable que l’Autriche, qui a ratifié l’Anschluss réalisé de force le 12 mars 1938 par 99, 7% des suffrages, a vu dans cette histoire édifiante une façon de racheter moralement, sinon politiquement, son image plus que collaborationniste. D’où la reconnaissance de Jägerstätter comme martyr en 2007 par Benoit XVI puis sa béatification par l’Église autrichienne, geste éminemment politique. Mais que dire alors de la résistance active de tous ceux qui ailleurs en Europe ont pris le maquis au péril de leur vie pour détruire l’ennemi et sauver des quantités de leurs compatriotes? Ils ont agi, eux, et ont été torturés et exécutés froidement pour cela sans être reconnus par aucune institution. Seul le mémorial Yad Vashem de Jérusalem a désigné et honoré les « Justes parmi les nations », pour avoir sauvé des Juifs.
Entre le Bien et le Mal
Le problème que pose la deuxième partie du film est le choix que doit faire Franz entre sa vie heureuse et son devoir moral, entre sa conception du Bien et du Mal, pourtant difficiles à identifier clairement. La Seconde Guerre mondiale reste presque invisible. Les champs de blé remplacent les champs de bataille et seules quelques séquences où des militaires viennent pacifiquement dans le village évoquent dans la première partie la puissance militaire.
On ne peut s’empêcher de comparer cette sérénité édénique à la force de la séquence inaugurale du film de Quentin Tarantino Inglourious basterds, où l’officier nazi vient terroriser avec un flegme sadique une famille de paysans qui cache des juifs. Franz, lui, doit affronter de plus en plus les villageois de Radegund – microcosme emblématique d’un pays incapable de tout discernement – qui, par peur de subir les conséquences de sa conduite, ostracisent progressivement toute sa famille. Mais aussi les soldats qui l’incarcèrent dès qu’il se présente à la caserne après son enrôlement et refuse de prononcer le serment d’allégeance au Reich, s’exposant ainsi à la torture et à l’isolement en prison, évoqués par les bruits sinistres des fusils et des bottes.
Une vie cachée est cependant bien un film de guerre, dans lequel le conflit, sans être montré frontalement, est plutôt suggéré par des symboles – narration et contemplation se mêlant à la manière habituelle de Malick. Les décors et les visages sont de plus en plus déformés par l’objectif grand angulaire comme pour traduire la perversion croissante de la réalité et la souffrance du personnage. Car il s’agit surtout ici d’un conflit intérieur. Franz est, semble-t-il, le seul de son village à identifier la « bête immonde» . Sa conscience de chrétien lui impose le rejet d’une idéologie dominatrice et meurtrière. Son cas de conscience est très longuement analysé, ses atermoiements longuement pesés et soupesés. Mais le prêtre, les gens de son village, les SS qui l’arrêtent et l’emprisonnent et l’officier nazi chargé de le juger (Bruno Ganz) ont peut-être raison de lui faire remarquer que sa vie infime et obscure ne va pas vraiment changer grand chose. Mais Franz ne veut rien changer, il ne veut pas cautionner.
Si Paul dit dans l’Épître aux Romains : « Que tout homme soit soumis aux autorités au-dessus de lui » (13 : 1), le cinéaste fait au contraire de lui l’incarnation admirable de l’homme seul capable de se dresser contre une foule apeurée et moutonnière qui, craignant des représailles, le met à l’écart. Il cite la romancière George Eliot à la fin du film pour en attester :
« The growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts; and that things are not so ill with you and me as they might have been, is half owing to the number who lived faithfully a hidden life, and rest in unvisited tombs. »
« Le développement du bien dans le monde dépend en partie d’actes non historiques ; et le fait que les choses n’aillent pas aussi mal pour vous et moi qu’elles le pourraient est aussi dû au nombre de ceux qui vécurent loyalement une vie cachée et reposent dans des tombes invisibles »(George Eliot, Middlemarch).
Franz est-il un martyr ? Frank Lestringant démontre dans son livre Lumière des martyrs. Essai sur le martyre au siècle des Réformes (Honoré Champion, 2004) que, pour qu’il y ait martyre dans le cas des pérsécutions religieuses, il faut au préalable transformer la cause du martyr en Cause, c’est-à-dire faire du mot le synonyme de l’Église invisible du Christ. À ce moment-là, le titre de martyr est élargi à l’ensemble des fidèles. Mais le cas de Franz est politique, donc différent de celui des victimes des guerres de religion, assassinées en masse ou converties de force et il est difficile de considérer l’Église autrichienne tout entière, qui a recommandé l’allégeance à Hitler, comme martyre. Franz se conduit en victime du devoir de vérité. « Un homme peut-il se laisser mettre à mort ? Pour la vérité ? Se peut-il que cela plaise à Dieu ? », se demande-t-il. S’agit-il d’Imitatio Christi, du souvenir des paroles de Jésus dans Matthieu 10 : 22 : « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » ? Son procès inique est-il un rappel du jugement de Ponce Pilate ? Et Hitler est-il pour lui une figure de l’Antéchrist ?
Une « belle âme »?
Malick a certes voulu suggérer tout cela. Le sacrifice christique est la voie du « bon chrétien ». Son humilité et son anonymat (d’où le titre du film) en sont le fondement. Mais il n’est pas interdit de penser que c’est son épouse qui se sacrifie vraiment en lui donnant son appui de manière à lui enlever tout remords et que s’il y a une martyre, c’est plutôt Fani ; car Franz, cet homme intransigeant qui se place au-dessus de toute considération historique concrète, qui sacrifie de ce fait délibérément sa famille, sa ferme, son bonheur pour une très haute idée de son devoir, peut apparaître comme la belle âme que critique Hegel dans la morale de Kant (voir sur le blog de Didier Moulinier, « La belle âme et la loi du cœur : de la dialectique à l’analyse. Hegel, Freud, Lacan » http://philosophie-et-psychanalyse.blogspot.com/2010/12/la-belle-ame-et-la-loi-du-coeur-de-la.html).
Ne tenant pas compte, selon Kojève, de l’interaction entre la liberté et la nature, ni de l’interaction entre les motifs personnels d’agir et les motifs universels, elle préfère au bonheur le devoir dans toute son idéalité et refuse l’action. Conception rigoureuse sinon rigide du monde que Kant a transmise aux Romantiques allemands, dont elle construit la vision esthétique et religieuse, qui exige de vivre en conformité avec soi-même. Jägerstätter serait donc à la fois la belle âme selon Schiller qui unit l’instinct et le devoir et dont Goethe peut dire qu’elle repose « sur les plus nobles duperies et sur la plus subtile confusion du subjectif et de l’objectif » (cf. Confessions d’une belle âme, note 74. p. 177) ; la belle âme contemplative universelle, qui se sent libre de tout devoir déterminé quelconque, mais non bien sûr de l’universalité du devoir lui-même ; et la belle âme proprement dite selon Novalis qui, convaincue de ce que « la voix intérieure de son savoir immédiat est voix divine » (Phénoménologie de l’esprit, p. 186), veut réaliser intérieurement l’amour christique et ne peut se soustraire à la violence du monde. C’est l’attitude suicidaire de la conscience malheureuse qui vit « dans l’angoisse de souiller la splendeur de son intériorité par l’action et l’être-là, et, pour préserver la pureté de son cœur, fuit le contact de l’effectivité et persiste dans l’impuissance entêtée, impuissance à renoncer à son Soi affiné jusqu’au suprême degré d’abstraction ». Freud et Lacan ont montré que sa jouissance narcissique est à la mesure du malheur qu’elle s’inflige.
Symphonie pastorale et spirituelle, œuvre idéaliste, à la fois humaniste et sublime qui a obtenu le prix du jury œcuménique au dernier Festival de Cannes, Une vie cachée est un magnifique monument à la gloire des petits, des sans grade, des oubliés de l’Histoire. Mais le martyre volontaire de son personnage, le pays compromis et la période historique cruciale où se situe son intrigue, les épineux problèmes éthiques et politiques qu’elle pose en font une œuvre sujette à discussion et même discutable à tous les niveaux, et en particulier au niveau politique et philosophique, quelles que soient les idées et les croyances des spectateurs. Le débat dans une classe de seconde, de première ou de terminale, s’il parvient à éviter la polémique et la partialité religieuse, pourrait se révéler passionnant et très actuel.
Anne-Marie Baron
• « À la merveille », de Terrence Malick.
• « The Tree of Life » – « L’Arbre de vie » –, de Terrence Malick, Palme d’or du festival de Cannes.
• « Voyage Of Time » et « Song To Song ».
====================
Critique de LA LISTE DE SCHINDLER de Steven Spielberg à 20H45 sur Ciné + Emotion
Ci-dessous, mes photos de Liam Neeson au Festival du Cinéma Américain de Deauville 2012.
Avant que Spielberg ne réalise « La liste de Schindler », long aura été le parcours pour aboutir à ce film. Un premier projet de film avait ainsi tout d’abord échoué. C’est Poldek Pfefferberg, un des 1100 Juifs sauvés par Oskar Schindler, qui devait raconter la vie de ce dernier. Un film sur Schindler basé sur ce récit devait même être tourné avec la Metro Goldwyn Mayer en 1963. Presque 20 ans plus tard, en 1982, l’écrivain Thomas Keneally écrivit le livre « La Liste de Schindler » après avoir rencontré Pfefferberg. C’est ce livre qui servira de base au film éponyme de Spielberg. Universal Pictures en acheta les droits. Spielberg rencontra Pfefferberg et voulut d’abord confier la réalisation du film à Roman Polanski qui refusa puis à Scorsese qui refusa à son tour. C’est ainsi que Spielberg décida de le réaliser en raison, notamment, du génocide en Bosnie : « La principale raison pour laquelle j’ai tenu à réaliser ce film sans plus tarder, c’est que la purification ethnique qui sévit en Bosnie me persuade de plus en plus de la ressemblance terrifiante de notre époque avec celle où se déroula la Shoah. Je n’avais jamais, dans aucun de mes films, décrit la réalité. Je consacrais toute mon énergie à créer des mondes imaginaires. Je crois que si j’avais inversé mon plan de travail et tourné en premier « La Liste de Schindler », je n’aurais jamais éprouvé le moindre désir de réaliser, ensuite, un film sur les dinosaures. » Spielberg ne demanda pas de salaire pour ce film, ce qui aurait été pour lui « l’argent du sang ».
Suite au succès remporté par le film, Spielberg créa « la Fondation de l’Histoire Visuelle des Survivants de la Shoah », une organisation à but non lucratif qui rassemble des archives de témoignages filmés des survivants de l’Holocauste. L’argent récolté lui a également permis de produire des documentaires sur la Shoah pour la télévision comme « Anne Franck remembered » (1995), « The lost children of Berlin » (1996) « The Last days » (1998).
Le film a été tourné entre mars et mai 1993, en soixante-douze jours, essentiellement dans le quartier de Kazimierz à Cracovie.
C’est le 30 novembre 1993 que « La liste de Schindler » sortit en salles, soit trente ans après le premier projet de film sur Oskar Schindler. Cela valait la peine d’attendre. Un sujet comme celui-ci nécessitait talent, maturité, sensibilité, sobriété et travail de documentation. A chaque film sur l’Holocauste revient la même question : peut-on et doit-on faire une fiction d’une atroce réalité qui la dépasse ? Doit-on, pour transmettre l’Histoire, tenter de raconter l’indicible, forcément intransmissible ? Spielberg est-il parvenu à lever toutes les réticences ? Claude Lanzmann écrivit ainsi : « L’Holocauste est d’abord unique en ceci qu’il édifie autour de lui, en un cercle de flammes, la limite à ne pas franchir parce qu’un certain absolu de l’horreur est intransmissible : prétendre pourtant le faire, c’est se rendre coupable de la transgression la plus grave. »
Synopsis : Oskar Schindler (Liam Neeson) est un industriel allemand, membre du parti nazi. Bon vivant, profiteur, époux infidèle, il ne semble avoir qu’une obsession : faire du profit, et faire retentir son nom. Tandis que les Juifs sont regroupés et enfermés dans des ghettos, il réussit à obtenir les capitaux nécessaires (provenant de la communauté juive) pour racheter une fabrique de casseroles. Il emploie une main d’œuvre juive bon marché dans son usine, afin de la faire prospérer, apparemment indifférent à l’horreur qui se déroule en dehors de son usine. Il faudra la liquidation du Ghetto de Cracovie, en mars 1943, sous les ordres du commandant SS Amon Göth (Ralph Fiennes) pour qu’il prenne conscience de l’ineffable horreur nazie…
La première scène nous montre Schindler s’habillant méthodiquement, soigneusement, choisissant cravate, boutons de manchette, et épinglant sa croix gammée. Le tout avec la dextérité d’un magicien. Nous n’avons pas encore vu son visage. De dos, nous le voyons entrer dans une boite de nuit où se trouvent des officiers nazis et des femmes festoyant allègrement. Il est filmé en légère contre-plongée, puis derrière les barreaux d’une fenêtre, puis souriant à des femmes, puis observant des officiers nazis avec un regard mi-carnassier, mi-amusé, ou peut-être condescendant. Assis seul à sa table, il semble juger, jauger, dominer la situation. Sa main tend un billet avec une désinvolte arrogance. Son ordre est immédiatement exécuté. Son regard est incisif et nous ignorons s’il approuve ou condamne. Il n’hésite pas à inviter les officiers nazis à sa table, mais visiblement dans le seul but de charmer la femme à la table de l’un d’entre eux. Cette longue scène d’introduction sur la musique terriblement joyeuse (« Por una cabeza » de Gardel), et d’autant plus horrible et indécente mise en parallèle avec les images suivantes montrant et exacerbant même l’horreur qui se joue à l’extérieur, révèle tout le génie de conteur de Spielberg. En une scène, il révèle tous les paradoxes du personnage, toute l’horreur de la situation. L’ambigüité du personnage est posée, sa frivolité aussi, son tour de passe-passe annoncé.
Un peu plus tard, Schindler n’hésitera pas à occuper l’appartement dont les occupants ont dû rejoindre le Ghetto. Il faudra que de son piédestal -des hauteurs du Ghetto, parti en promenade à cheval avec une de ses maîtresses- il observe, impuissant, le massacre du Ghetto de Cracovie. Il faudra que son regard soit happé par le manteau rouge d’une petite fille (Spielberg recourt à la couleur comme il le fera à cinq autres occasions dans le film) perdue, tentant d’échapper au massacre (vainement, comme nous le découvrirons plus tard) pour qu’il prenne conscience de son identité, de l’individualité de ces juifs qui n’étaient alors pour lui qu’une main d’œuvre bon marché. Créer cette liste sera aussi une manière de reconnaître cette individualité, de reconnaître qu’à chaque nom correspond une vie sauvée. Sans doute la démarche d’une jeune femme qui lui demande plus tard de faire venir ses parents détenus à Plaszow parce qu’elle a eu écho de sa bonté, qu’il renvoie menaçant de la livrer à la Gestapo tout en lui donnant gain de cause, l’aura-t-elle incité à devenir celui pour qui on le prenait déjà, cet « homme bon », à faire retentir son nom, mais d’une autre manière (là encore, le paradoxe d’Oskar Schindler, il ne recevra pas la jeune femme la première fois, non maquillée et pauvrement vêtue mais seulement lorsqu’elle reviendra maquillée et avec d’autres vêtements). A partir de ce moment, il tentera alors avec son comptable Itzhak Stern (Ben Kingsley), de sauver le plus de vies possibles.
La scène précitée du massacre qu’observe Schindler est aussi nécessaire qu’insoutenable (une quinzaine de minutes) entre les exécutions, les médecins et infirmières obligés d’empoisonner les malades dans les hôpitaux pour leur éviter d’être exécutés, les enfants qui fuient et se cachent dans des endroits tristement improbables, l’impression d’horreur absolue, innommable, de piège inextricable, suffocant. La scène est filmée caméra à l’épaule (comme 40% du film) comme si un reporter parcourait ce dédale de l’horreur et, comme dans tout le film, Spielberg n’en rajoute pas, filme avec sobriété cette réalité reconstituée qui dépasse les scénarii imaginaires les plus effroyables. Des valises qui jonchent le sol, un amas de dents, de vêtements, une fumée qui s’échappe et des cendres qui retombent suffisent à nous faire comprendre l’incompréhensible ignominie. Les échanges, implicites, entre Schindler et le comptable Stern sont aussi particulièrement subtils, d’un homme qui domine l’autre , au début, à la scène deux hommes qui trinquent sans que jamais l’horrible réalité ne soit formulée.
Le scénario sans concessions au pathos de Steven Zaillian, la photographie entre expressionnisme et néoréalisme de Janusz Kaminski (splendides plans de Schindler partiellement dans la pénombre qui reflètent les paradoxes du personnage), l’interprétation de Liam Neeson, passionnant personnage, paradoxal, ambigu et humain à souhait, et face à lui, la folie de celui de Ralph Fiennes, la virtuosité et la précision de la mise en scène (qui ne cherche néanmoins jamais à éblouir mais dont la sobriété et la simplicité suffisent à retranscrire l’horrible réalité), la musique poignante de Johns Williams, et le message d’espoir malgré toute l’horreur en font un film poignant et magistral.
« La liste de Schindler » a d’ailleurs reçu douze nominations aux Oscars en 1994 et en a remporté sept dont ceux du meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleure direction artistique, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleure photographie et meilleure musique. Liam Neeson et Ralph Fiennes ont évidemment été tous deux nommés pour l’Oscar du meilleur acteur, pour le premier, et celui du meilleur second rôle masculin, pour le second, mais ce sont Tom Hanks, pour « Philadelphia », et Tommy Lee Jones, pour « Le Fugitif » qui les ont obtenus.
Alors, pour répondre à la question initiale, oui, il faut et il fallait faire un film sur ce sujet car certes « un certain absolu de l’horreur est intransmissible », forcément, mais cela n’empêche pas d’essayer de raconter, de transmettre pour que justement cet absolu de l’horreur ne se reproduise plus. Ce film permet à ceux qui ont regardé avec des yeux d’enfants éblouis les autres films de Spielberg, d’appréhender une horreur que leurs yeux n’auraient peut-être pas rencontrée autrement, trop imperméables à des films comme « Nuit et brouillard » ou « Shoah ».
Comme l’avait fait Benigni avec « La vie est belle » là aussi fortement contesté (retrouvez ma critique de « La vie est belle » en cliquant ici et celle de « Monsieur Klein » de Losey en cliquant là, deux films indispensables, revoyez également « Le Pianiste » de Polanski), Spielberg a choisi la fiction, mais n’a surtout pas occulté la réalité, il l’a simplement rendue visible sans pour autant la rendre acceptable. Une scène en particulier a pourtant suscité une relative controverse, celle lors de laquelle des femmes sont envoyées dans une « douche » à Auschwitz-Birkenau, ignorant si en sortira un gaz mortel. Quand la lumière s’éteint, c’est aussi la certitude du spectateur avant que l’eau ne jaillisse. Scène terrible et par laquelle Spielberg n’a en aucun cas voulu faire preuve d’un suspense malsain mais a brillamment montré quel pitoyable pouvoir sur les vies (parallèle avec le passionnant dialogue sur le pouvoir entre Schindler et Göth) détenait les tortionnaires des camps qui, d’un geste à la fois simple et horrible, pouvaient les épargner ou les condamner.
« La liste de Schindler » est un film nécessaire et indispensable. Par le prisme du regard d’un homme avec tout ce que cela implique de contradictions (au sujet duquel le film a l’intelligence de ne jamais lever tout à fait le mystère) qui, d’indifférent devint un « Juste » et sauva 1100 juifs, il nous fait brillamment appréhender l’indicible horreur et montre aussi que des pires atrocités de l’humanité peuvent naitre l’espoir. Quand un sondage sidérant, à l’occasion de la commémoration des 70 ans de la Rafle du Vel d’Hiv, vient de révéler que 57% des 25-34 ans, 67% des 15-17 ans, ignorent tout de la Rafle du Vel d’Hiv (42% tous âges confondus) et (comment est-ce possible ?!) des films comme celui-ci continueront d’avoir leur raison d’être. C’est aussi un film sur le pouvoir, celui, pathétique et exécrable, de ceux qui en abusent ou de celui qui le détourne à bon escient, celui du cinéma, instrument du devoir de mémoire.
Un film dont vous ressortirez abattus, en colère, bouleversés mais aussi avec le sentiment que le pire peut transformer un homme et faire naitre l’espoir en l’être humain malgré les ignominies dont il peut se rendre capable ; et avec des images, nombreuses, à jamais gravées dans vos mémoires parmi lesquelles celle d’un manteau rouge, lueur tragique et innocente au milieu de l’horreur ou celle de la fin, ces pierres posées sur une tombe par des rescapés et acteurs pour remercier un homme pour toutes les vies qu’il aura sauvés et pour celles, qui grâce à sa liste, à ces noms et identités écrits et affirmés, auront pu voir le jour.
http://www.inthemoodforcinema.com/archive/2016/04/13/critique-de-la-liste-de-schindler-de-steven-spielberg-a-20h4-5788021.html
------------------------------
Ce dossier, dont on trouvera un extrait ci-dessous, ne contient pas — contrairement à d'autres plus récents réalisés par les Grignoux — d'animations immédiatement exploitables en classe. Il s'adresse aux enseignants du secondaire qui verront le film La Liste de Schindler avec leurs élèves entre quatorze et dix-huit ans environ.
Un film efficace
Le film de Spielberg suscite peu d'objections d'un point de vue historique : il reste en fait fort proche de ses sources avouées (comme le livre de Keneally) et de ses sources documentaires (comme l'ouvrage de Raul Hilberg), se risquant à très peu d'interprétations personnelles.
Ce respect de la vérité historique ne doit cependant pas cacher l'important travail de mise en scène de Spielberg, travail dont les effets dépassent largement le souci d'authenticité. L'exemple de la scène des douches à Auschwitz permettra immédiatement de mesurer l'importance de ce travail. Dans l'ouvrage de Keneally, cette scène est rapportée de la manière suivante :
«Elles [c'est-à-dire le groupe de femmes de la liste de Schindler] pataugèrent dans la boue jusqu'à la salle d'épouillage et de douches où des femmes, matraque en main, leur donnèrent l'ordre de se déshabiller. Mila Pfefferberg, qui, comme la plupart des prisonniers des camps, avait entendu parler des pommes de douche dont sortaient des gaz mortels, poussa un soupir de soulagement quand l'eau glacée se mit à couler.»
On voit immédiatement la différence de traitement entre le récit livresque et la mise en images de Spielberg. Ce qui est résumé en une phrase sans aucun pathos devient une longue scène où la caméra portée à l'épaule se mêle au groupe de femmes dont elle nous montre les visages terrifiés, où nous entendons leurs cris avant qu'une lourde porte apparemment étanche se referme sur elles, où enfin la lumière inexplicablement s'éteint au moment où regards et caméras se portent vers les pommes de douches au plafond. Même si on est peu sensible aux techniques cinématographiques, l'on comprend immédiatement que toute la mise en scène de Spielberg est destinée à favoriser la participation émotionnelle du spectateur, à provoquer sa peur, son angoisse et finalement son soulagement lorsqu'il constate que c'est bien de l'eau qui s'écoule de ces douches.
Le film de Spielberg ne vise pas seulement à dire une vérité mais aussi à produire des effets comme la participation subjective du spectateur, l'émotion, l'identification, la peur, le soulagement... Peut-on alors préciser quels sont ces effets privilégiés et comment ils sont produits tout au long du film?
[...]
Un acteur collectif
Il n'y a pas de véritable héros dans La Liste de Schindler — même si l'industriel allemand joue évidemment un rôle central — ni de projet d'ensemble qui guiderait l'action des personnages. Schindler en particulier change de but à peu près aux trois quarts du film : renonçant à faire fortune, il décide seulement alors de sauver les ouvriers de son usine. Quant à ceux-ci, leur but principal est évidemment de survivre mais cela ne dépend malheureusement pas uniquement d'eux-mêmes, ce qui ne leur permet pas d'organiser une action qui structurerait l'ensemble du film. Goeth enfin, s'il domine la seconde partie du film, reste un fonctionnaire subalterne dans la machinerie nazie qui le dépasse. Ces personnages ne sont donc pas maîtres de leur destin et ils subissent la plupart du temps des événements qu'ils ne dominent pas (Goeth et Schindler ayant cependant une plus large autonomie).
La ligne de force du film reste bien ainsi l'Histoire dont Spielberg entend rendre compte, celle de la destruction des Juifs d'Europe et du sauvetage miraculeux d'un millier d'entre eux par Oskar Schindler. Il s'agit de l'histoire d'un groupe et plus largement de tout un peuple, les récits individuels se raccrochant comme des bribes clairsemées à ce fil conducteur. Ainsi, même si Spielberg focalise à de nombreuses reprises notre attention sur des personnages particuliers, l'identification principale se fait à toute une communauté menacée d'extermination.
Un double destin
Cette évocation du sort de toute une communauté s'opère néanmoins, on l'a vu, de façon indirecte à travers le destin d'un groupe dont l'histoire diverge de plus en plus par rapport à celle de l'ensemble de cette communauté, puisqu'il s'agit de survivants (on estime qu'environ 3 millions de Juifs polonais ont été massacrés sur une population 3,3 millions, soit 90,9% — chiffres cités par le Mémorial de la Shoah). Du point de vue de l'implication émotionnelle du spectateur, ce fait est extrêmement important.
Un sujet comme l'extermination des Juifs est, on le sait bien, extrêmement pénible à évoquer, et Spielberg n'épargne pas la sensibilité de ses spectateurs. Il montre dans toute son horreur la brutalité nazie, qu'il s'agisse de la liquidation du ghetto de Cracovie, d'une sélection dans un camp où l'on élimine ceux qui ne sont plus «aptes» au travail, ou de l'exhumation des cadavres de victimes juives, brûlés ensuite sur un gigantesque bûcher. De ce point de vue, les bribes d'histoires individuelles que raconte Spielberg sont également souvent tragiques : l'ouvrier manchot qui tient à remercier Schindler pour sa bonté (ce qui a d'ailleurs le don d'agacer l'industriel qui se rend compte alors que son comptable Stern a engagé des gens manifestement improductifs) sera tué à la séquence suivante par un des soldats allemands qui ont arrêté la colonne de Juifs pour les obliger à déblayer la neige. Semblablement, la petite fille vêtue de rouge qui erre dans le ghetto, le jeune homme terrorisé que Goeth emploie à son service seront finalement abattus avec des milliers d'autres anonymes.
Un groupe restreint
Mais, plus le film avance, plus nous nous identifions à ce groupe restreint qui va finalement échapper au massacre. Même si la progression n'est pas linéaire, le film nous fait assister à un sauvetage extraordinaire dont nous retirerons finalement un sentiment de soulagement, sentiment d'autant plus intense que l'épreuve aura été terrible. L'organisation générale du film et la manière dont il sollicite à ses différents moments le spectateur sont à cet égard extrêmement significatifs.
Si les premières séquences suscitent essentiellement notre indignation (les expulsions, la formation du ghetto) ou notre crainte (les menaces nazies, Stern raflé «par erreur»), le premier meurtre survient après 40 minutes environ : il s'agit de l'ouvrier manchot abattu en pleine rue. Ce meurtre brutal reste cependant isolé (par rapport à ce que nous montre le film) jusqu'à ce que Goeth apparaisse deux séquences plus loin et ordonne presque immédiatement d'abattre l'ingénieure juive qui proteste à cause des défauts de la construction (53e minute du film).
Commence alors une séquence particulièrement éprouvante, celle de la liquidation du ghetto de Cracovie qui dure plus d'un quart d'heure (de la 54e à la 71e minute). On assiste à la mort d'un homme abattu brutalement dans un couloir, à celle d'un gosse en pleine rue et de celui qui a pris vainement sa défense, au meurtre d'une femme accompagnée d'un médecin, à l'assassinat volontaire des malades à l'hôpital dont les cadavres seront ensuite mitraillés par les soldats allemands. S'y ajoutent des images de destruction comme tous ces bagages répandus à la volée par les SS. Spielberg nous montre ensuite comment certains ont réussi à survivre, Poldek en feignant d'obéir à l'ordre de ramasser les valises dans la rue, une femme se réfugiant simplement sous un escalier d'où un petit garçon viendra la chercher pour la mettre dans la «bonne file». Il s'agit cependant d'un répit de courte durée car les Allemands reviennent la nuit pour liquider tous ceux qui se sont cachés dans les endroits les plus invraisemblables pour échapper aux rafles : à ce moment, il n'est plus question semble-t-il de sélection et tous sont mitraillés sans pitié.
Pour le spectateur sans doute, l'impression d'ensemble de cette séquence est celle d'un désastre total que symbolise le plan suivant qui nous montre Schindler devant les casseroles vides alignées dans son usine désertée : tout semble effectivement anéanti, alors que nous sommes à peu près au premier tiers du film.
Une tension constante
Le récit se poursuit néanmoins avec les survivants rassemblés au camp de travail de Plaszow. Si les ouvrières pensent un court instant que «le pire est passé», Goeth va immédiatement les démentir en tuant de son balcon deux détenues choisies au hasard. Si la destruction du ghetto avait représenté une phase cruciale du processus de dégradation (celle du meurtre de masse), tout ces épisodes au camp de Plaszow seront marqués par une tension continue, scandée par de brefs accès de violence. Les meurtres systématiques ont pris fin (dans le film), Goeth multipliant cependant les exactions sans que l'issue en soit toujours fatale : il voudra abattre le rabbin préposé à la fabrication des charnières mais son pistolet finalement s'enrayera. Plus ambiguë de ce point de vue est la séquence déjà analysée où le chef nazi cherchera à savoir qui a volé un poulet : un détenu sera tué au hasard, mais la réponse du gamin (désignant le mort comme étant le voleur) épargnera au spectateur un nouveau meurtre. Comme on l'a montré, à la douloureuse impression que suscite cet assassinat succède pour le spectateur le soulagement provoqué par cette réponse imprévue.
Toute cette partie reste cependant marquée par une très grande tension, Spielberg nous montrant par exemple, dans une séquence ultérieure, comment Goeth a abattu un homme sur deux dans un groupe de détenus pour un motif futile. Pendant près de 45 minutes (de la 75e à la 120e minute environ), le spectateur subit cette atmosphère oppressante avec de brefs moments de répit (Schindler sauvant le couple Perelman) mais aussi de crainte (Goeth s'approchant de Helen) et de cruauté (les assassinats répétés). Subjectivement, l'on peut donc avoir l'impression pendant cette période d'être tombé «au plus bas».
Une sélection horrible
La fin de cette partie sera cependant suivie par une nouvelle épreuve, particulièrement horrible, la sélection des inaptes qui durera plus de cinq minutes (de la 120e à la 127e minute). Les victimes de cette épreuve resteront cependant anonymes, et Spielberg nous montrera seulement les réactions des femmes qui ont échappé à la sélection et sont en train de se rhabiller. Nous sommes sur le point de partager leur soulagement lorsqu'elles s'aperçoivent que, sur ces entrefaites, les gardes ont embarqué leurs enfants sur des camions, ce qui déclenche un mouvement de panique et de révolte parmi les détenues. Ici aussi cependant, Spielberg prend, si l'on peut dire, le parti d'un enfant qui, échappant aux gardes, cherche d'abord vainement une cachette avant de se réfugier dans des latrines remplies à ras bord. On perçoit donc l'ambiguïté de toute cette séquence : selon son tempérament, chaque spectateur sera plus ou moins sensible à l'horreur de la situation et au sort tragique de ceux que la sélection a éliminés, ou retiendra au contraire le soulagement, même s'il est teinté de malaise, de ceux qui viennent d'échapper à la mort. En s'attardant sur des personnages qui sont déjà familiers (ou qu'il nous rend familiers) et en laissant les victimes dans l'anonymat, Spielberg focalise en tout cas notre attention sur le destin de ces survivants qui deviennent de plus en plus des exceptions.
La séquence suivante où Schindler s'efforcera d'arroser les wagons stationnant en plein soleil nous rappelle pourtant l'horreur de l'ensemble de cette situation. Les victimes enfermées dans ces wagons plombés restent néanmoins anonymes, la caméra suivant de façon privilégiée Schindler en butte aux sarcasmes des SS. Le personnage, dont l'héroïsme devient manifeste, risque ainsi de passer à l'avant-plan devant des victimes qui restent elles plongées dans l'ombre.
Après une séquence racontant l'arrestation de Schindler, Spielberg nous montrera en une scène effroyable (de la 133e à la 136e minute) comment les nazis ont essayé d'effacer les dernières traces de leurs crimes : dans ce gigantesque bûcher, Schindler reconnaîtra notamment la petite fille vêtue de rouge qu'il avait vu déambuler dans le ghetto de Cracovie. C'est à ce moment que Goeth lui apprend la liquidation prochaine du camp de Plaszow et le départ des détenus pour Auschwitz. Cette annonce dans ce décor apocalyptique suscite une très forte attente chez le spectateur : l'extermination est programmée, et nous pouvons désormais craindre le pire.
Le basculement du récit
Après une brève discussion avec Stern, ses valises bourrées d'argent, prêt à partir fortune faite, Schindler va engager une négociation décisive avec Goeth et obtenir par la corruption le transfert de ses ouvriers vers le camp spécialement aménagé de Brinnlitz. Bientôt (aux alentours de la 145e minute), nous verrons ceux qui ont été retenus sur cette liste s'embarquer pour ce lieu providentiel : parmi eux, l'on reconnaîtra notamment Helen Hirsch qui aura fait l'objet d'une dernière négociation difficile entre Goeth et Schindler. A l'entame du dernier quart du film s'opère ainsi un basculement décisif, le spectateur focalisant à présent son attention sur un groupe de personnages dont il espère désormais raisonnablement le sauvetage. Après la courbe descendante du début du film, après le long enfer de Plaszow, le spectateur est à présent engagé sur une courbe nettement ascendante, l'espoir apparaissant à présent possible.
L'arrivée des hommes à Brinnlitz confirmera cette impression de sortie hors de l'enfer, mais la séquence suivante nous rappellera brutalement que l'horreur est toujours présente. Cette séquence joue en fait sur toutes les virtualités de la situation, telles que les a dessinées le film : l'arrivée des femmes à Auschwitz (que le spectateur un peu averti reconnaît immédiatement) semble dans la droite ligne du processus de dégradation entamé depuis le début du film, et, même si une courte séquence insérée nous avertit qu'il s'agit d'une erreur administrative, nous redoutons le pire, c'est-à-dire que les douches ne cachent effectivement des chambres à gaz. Ce n'est pourtant pas le cas, et Schindler arrivera bientôt à Auschwitz, confirmant ainsi son rôle de sauveur providentiel.
Toute cette séquence (de la 150e à la 160e minute) n'aura donc été qu'une épreuve supplémentaire, particulièrement terrifiante, dans une courbe qui est à présent nettement ascendante. Le soulagement qu'en retire le spectateur n'empêche cependant pas Spielberg de montrer comme précédemment, la réalité des crimes nazis avec ces deux plans déjà évoqués de déportés qui sont conduits vers ce que l'on sait être des chambres à gaz. Ainsi, au moment où nous découvrons la dernière et la plus monstrueuse des étapes du processus de destruction des Juifs, nous nous identifions, sans doute intensément, à celles qui miraculeusement viennent d'y échapper.
La fin du film ne fera ensuite que confirmer ce mouvement ascendant, les femmes arrivant au camp de Brinnlitz, Schindler soudoyant les soldats à coups de schnaps, les dernières séquences nous montrant les Juifs réunis autour de Schindler dans une atmosphère de reconnaissance émue et chaleureuse. Le changement de ton dans cette partie est à ce point radical que, lorsque Schindler demandera au rabbin de célébrer le sabbat, l'on verra dans leur chambrée des gardiens allemands (qui sont encore à ce moment les «maîtres») interloqués, sans réaction, un peu comme si c'était eux qui étaient devenus les prisonniers des Juifs qui les entourent.
En résumé
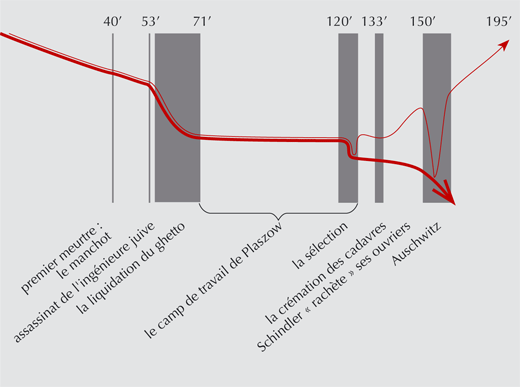
Ce schéma reprend les principaux épisodes du film avec les minutages correspondants. La courbe du bas représente la dégradation du sort des Juifs, telle qu'elle est retracée dans la Liste de Schindler, avec des infléchissements marqués lors par exemple de la liquidation du ghetto de Cracovie. La courbe supérieure représente le point de vue du groupe de Juifs repris sur la liste de Schindler auxquels s'identifie plus ou moins fortement le spectateur : cette courbe épouse d'abord celle de l'ensemble des Juifs, puis s'en éloigne avec la décision de Schindler de «racheter» ses ouvriers à Goeth. (On a indiqué par ailleurs pourquoi, à la fin de la sélection au camp de Plaszow, le spectateur s'identifie surtout aux rescapés et moins aux victimes destinées à l'extermination.) Enfin, la déportation vers Auschwitz se présente d'abord comme une catastrophe mais se révélera n'être qu'une épreuve qui ne parvient pas à interrompre un mouvement désormais ascendant.
La division du film en trois parties apparaît donc clairement : la première (jusqu'à la 53e minute) se présente comme un dégradation rapide et continue, la seconde (jusqu'à la 136e minute) comme un enfer permanent, la dernière soit comme l'étape ultime du processus de destruction soit comme un mouvement ascendant vers la libération.
Le dessin de la courbe supérieure dépend en partie de la sensibilité de chacun. On peut par exemple estimer qu'elle devrait avoir un mouvement beaucoup plus heurté pendant les séquences au camp de travail de Plaszow où alternent des moments de grande tension et de bref soulagement. Néanmoins, on tombera sans doute d'accord sur le fait que cette courbe présente un mouvement d'ensemble caractéristique de descente, de stabilisation au niveau le plus bas puis de remontée (avec quelques accidents).
Comment supporter l'insupportable?
En amenant le spectateur à s'identifier à un groupe de rescapés, Spielberg, on le voit, lui apporte finalement le soulagement d'échapper à une situation terrifiante et de participer à l'émotion d'une reconnaissance fraternelle (particulièrement accentuée dans la dernière séquence qui nous montre acteurs et personnages réels mêlés venant se recueillir sur la tombe de Schindler). Evoquant l'insupportable, la mort de centaines de milliers de personnes dans les chambres à gaz, l'extermination de tout un peuple, il parvient, après une véritable descente aux enfers, après des moments extrêmement durs et éprouvants pour le spectateur, à lui faire éprouver un intense sentiment de soulagement : plus l'épreuve aura été rude, plus sans doute ce soulagement sera grand. Cette économie générale du film, sa manière d'impliquer émotionnellement le spectateur et de lui apporter cette satisfaction finale, explique certainement pour une part le succès du film : en nous faisant adopter le point de vue d'un groupe de survivants, Spielberg a sans doute rendu supportable à la plupart d'entre nous l'évocation de l'insupportable. Il suffit de comparer La Liste de Schindler au film de Claude Lanzmann, Shoah, qui ne se préoccupe que des morts, pour se rendre compte que le documentaire laisse une tout autre impression, celle de l'horreur absolue.
On pourrait croire que cette impression différente résulte seulement de l'adoption par Spielberg d'un point de vue particulier, celui d'un groupe de rescapés, et non de la construction d'ensemble du film. Sur ce point, il faut cependant constater que La Liste de Schindler nous donne une vision extrêmement partiale des faits. L'espèce de soulagement que nous éprouvons à la fin du film ne fut pas celui des rares rescapés du génocide. En 1945, 90% de la communauté juive de Pologne avait été massacrée : à cette échelle, toutes les familles avaient été touchées, et chaque survivant devait compter des dizaines sinon des centaines de morts dans sa famille, ses proches, ses amis, ses connaissances. Ces survivants avaient le plus souvent perdu tous leurs biens, et ils n'avaient plus aucune place dans les décombres de la Pologne de l'après-guerre. En outre, s'ils avaient survécu, ils étaient passés par les épreuves les plus terribles, celles de la faim, de la peur, de l'humiliation, de l'abaissement le plus extrême Dans ces conditions, l'on comprend que les sentiments de ces rescapés, pour autant qu'on puisse les reconstituer, étaient sans doute fort éloignés du soulagement qu'exprime le film de Spielberg et mélangeaient de façon complexe l'impression d'un désastre total, la solitude, l'abandon, la honte même d'avoir survécu quand tous les proches étaient morts, l'avilissement parfois d'avoir survécu dans des conditions aussi humiliantes, la volonté aussi de témoigner ou au contraire d'oublier, l'incapacité en même temps de transmettre une expérience étrange et monstrueuse.
Il serait sans doute injuste de dire que La Liste de Schindler constitue une «machine à réjouir» le spectateur et que nous prenons le même type de plaisir à sa vision qu'à celle d'un film comme Jurassic Park où le soulagement succède également à la terreur. La Liste obéit, on l'a montré à suffisance, à une exigence de vérité, de témoignage, d'éducation même pour un large public. Mais les émotions qu'il procure, les effets qu'il produit restent, on le voit, très éloignés de l'expérience dont il essaie de rendre compte et qui reste en définitive indicible.








